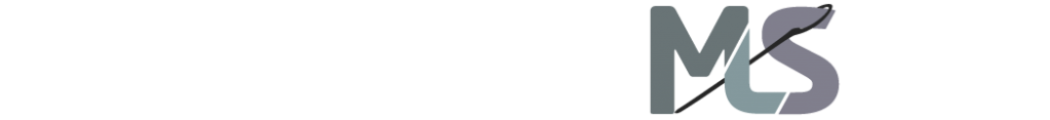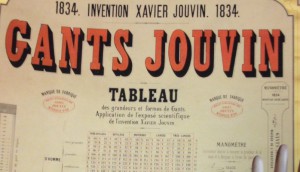Archives du Musée de Roubaix
Pour une entreprise, la numérisation est une action qui s’inclue, à un moment opportun, dans toute démarche de préservation du patrimoine vivant.
Pour comprendre ce que cela implique, nous avons rencontré Émeline Dodart-Gosse fondatrice de Num&Patrimoines qui accompagne les sociétés qui se lancent dans cette aventure.
Études de faisabilité, conseils dans le choix des prestataires puis si nécessaire dans un contrôle qualité, font partie intégrante de ses missions.
L’aide précieuse de cette spécialiste expérimentée qui va guider ceux qui se sentent démunis face aux nombreux choix à faire avant même de mener à bien leurs projets.
Numériser son patrimoine vivant est une protection utile, permet un accès simplifié et rapide à ses archives pour en faire un outil de communication efficient.
Concernant les marques de mode, les archives étant les gardiennes du style, la numérisation prend tout son sens.
MLS Conseil : Quel parcours vous a conduit jusqu’à la numérisation ?
Num&Patrimoine : Au cours de mes études en histoire de l’art médiéval, portant notamment sur les manuscrits enluminés, j’ai dû consulter beaucoup d’images. Alors qu’à cette date la numérisation en était à ses balbutiements, la base Mandragore de Gallica[1] existait et j’ai pu y trouver les éléments nécessaires à mes recherches. De là, un nouvel intérêt a surgi : mixer l’histoire de l’art et les nouvelles technologies.
Puis, le Master Pro sur la numérisation dans lequel je me suis engagée, m’a passionné et m’a permis d’accéder rapidement à un premier poste à la Bibliothèque Nationale de France en tant que chargée de numérisation.
MLSC : Qu’est-ce que l’on appelle la numérisation ?
N&P : Numériser signifie rendre accessible d’un point de vue numérique tous types de documents. Ainsi, ils seront consultables, pour différents usages, dans des bibliothèques virtuelles, à partir d’un ordinateur.
Techniquement les possibilités sont nombreuses. On peut évidemment numériser des documents papiers – affiches, croquis, rouleaux de papyrus -, mais également des films – micro film, ektachrome -, ou encore les plaques de verre servant à la photographie.
Concernant les objets, en complément ou en substitution d’une prise de vues en 2D, il est possible de numériser en 3D. Cette dernière option permettra de pouvoir modéliser les objets puis de les faire tourner sur son écran pour se rendre compte de leurs volumes et de leurs proportions. Un travail sur les structures pour obtenir des rendus très réalistes est alors fait.
MLSC : Pourquoi décide-t-on de numériser ?
N&P : Au départ il est important de définir l’intérêt de la numérisation. Celle-ci doit répondre à un besoin et/ou un objectif et s’encadre dans un projet.
Pourquoi dématérialiser ? La réponse la plus simple à cette question est : pour sauvegarder son patrimoine. C’est évidemment vrai et les raisons qui justifient la protection sont nombreuses.
Citons le cadre de la gestion des risques (incendie, vol, inondation, déménagement), ou le cas d’une cession ou revente de l’entreprise (un patrimoine numérisé sécurise un acquéreur). L’intérêt juridique est aussi considéré parce qu’un document numérique peut servir à prouver un savoir-faire technique ou une création. Cela permet une réponse rapide et moins couteuse si une procédure est engagée. On connaît tous le problème des copies.
Il convient aussi de prendre conscience que des archives numérisées sont facilement exploitables. Une aubaine pour les services de communication interne et externe dont les besoins sont permanents.
En terme de valorisation, monter une exposition ou faire un film sera plus rapide à partir d’images disponibles et puis partager l’histoire de l’entreprise avec ses salariés se révèle bien souvent fédérateur.
Dans tous les cas, engager un programme de numérisation demande de préparer ses fonds. Cette première démarche est elle-même très bénéfique car elle permet d’organiser ses archives et s’interroger : qu’est-ce que j’identifie d’important dans mes archives que je veux protéger ?
MLSC : Que préconisez-vous aux entreprises qui envisagent une future numérisation ? Y-a-t-il des précautions à prendre ?
N&P : Je conseille toujours de porter attention à tout ce qui va constituer son fonds d’archives.
Rassembler les documents dans un même lieu de stockage, être vigilant à l’humidité, la lumière et les variations de température. Il est préférable d’être dans un endroit un peu trop chaud mais à température constante, qu’un hangar où les écarts vont être importants.
Enregistrer les données sur un tableur par thématique : création, commercial, publicité, presse, etc…….
Identifier ses procédés de création de produits et de fabrication et ne pas oublier de dater tous les documents.
MLSC : Qu’est-ce qu’une entreprise peut faire à partir ses archives numérisées ?
N&P : Le simple fait que l’on choisisse de rendre disponibles ses informations à partir de sites ou de plateformes digitales ouvre des possibilités infinies et pour une audience internationale.
Les chercheurs, historiens, étudiants auxquels l’entreprise pourrait donner un accès complet ou partiel, pourront être dans n’importe quel pays du monde. À partir de cela on peut tout imaginer !
MLSC : Y a-t-il un intérêt spécifique pour les entreprises du secteur textile et mode ?
N&P : Il est évident ! Les bureaux de style s’appuient sur les créations historiques de la marque pour s’en emparer et les revisiter. On peut aussi numériser des textiles.
Une nouvelle fois le gain de temps est appréciable car des images indexées correctement se trouvent vite. Dans un classeur classique, le rangement des collections se fait par saison. Avec une option dématérialisée, on va utiliser les mots clés : « robe, crêpe, 3 trous » et les réponses apparaissent, multiples. Tous les dessins de ces robes, leurs fiches techniques, une photo, la date de création, etc…… et éventuellement le produit en 3D.
MLSC : Prenons un cas d’école très précis, celui une entreprise de tissage qui édite beaucoup de modèles de tissus. En quoi le fait d’avoir ses textiles numérisés constitue une valeur ajoutée pour ses clients ?
N&P : Je dirais simplement pour répondre vite, mieux et plus à son client. Le gain de temps pour que les équipes de style puissent faire une proposition rapide au client est indéniable.
Il est aussi possible d’utiliser un catalogue numérique pour la prospection commerciale.
MLSC : Quel est le moment adéquat pour une entreprise de démarrer la numérisation de ses archives ?
N&P : Les entreprises au patrimoine historique ancien et important fonctionneront par campagnes car le travail sur le rétroactif peut être long et couteux. Mais tout est possible. Lorsque je discute avec mes clients, on évoque le minimum mais aussi le maximum. Il choisit où il met son curseur. Je le conseille sur ce que je considère comme essentiel.
Pour les entreprises plus récentes, nous sommes sur une question d’archivage électronique puisqu’elles travaillent déjà avec les solutions digitales. Dans ce cas, l’accent sera mis sur le produit fabriqué et la campagne de numérisation pourra être faite à chaque fin de saison.
Si les grands groupes du luxe mettent l’accent sur la numérisation pour toutes leurs filiales c’est qu’il y a un vrai retour sur investissement. Certes ils possèdent un budget, mais ils n’investissent pas ces sommes d’argent sans raison.
[1] Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. En libre accès, elle regroupe des livres numérisés, des cartulaires, des revues, des photos et une collection d’enluminures. Source Wikipédia.